A moins d’un an des élections législatives prévues en juin 2026, le roi du Maroc donne de la perspective et dessine l’exigence et l’horizon à atteindre. Son discours prononcé à l’occasion des 26 ans de son règne a été l’occasion de dresser un cap clair à un moment charnière pour le pays : consolider les acquis économiques, corriger les inégalités territoriales, relancer le lien avec l’Algérie.
Chaque prise de parole officielle du roi Mohammed VI revêt une portée stratégique, en particulier à l’occasion de la Fête du Trône, devenue au fil des ans un rendez-vous très attendu au Maroc comme à l’international. Ce 29 juillet, le souverain a prononcé le dernier discours du Trône avant les élections législatives de juin 2026, marquant la fin d’un cycle politique.
Sans s’immiscer dans le jeu partisan, le souverain chérifien fixe le cap : celui d’un État structurant et réformateur. La grâce royale exceptionnelle accordée à près de 20.000 détenus en offre une illustration concrète. Rare par son ampleur, cette mesure s’inscrit dans une volonté d’humanisation de la justice, en résonance avec les chantiers en cours dans le domaine judiciaire.
Dans ce sillage, Mohammed VI choisit de remettre l’église au centre du village : replacer l’équité territoriale au cœur de l’agenda politique national. Un recentrage d’autant plus stratégique que le Maroc aborde 2026 dans un environnement régional incertain, mais fort de plusieurs acquis : une croissance qui résiste, une industrie en mutation et un positionnement international consolidé. Retour sur les leviers de cette stabilité revendiquée.
Croissance, industrie, souveraineté : le triptyque économique du royaume chérifien

« En dépit de la succession d’années de sécheresse et de l’exacerbation des crises internationales, l’économie nationale a maintenu un taux de croissance conséquent et régulier, au cours des dernières années », a affirmé le monarque, en revendiquant une trajectoire de stabilité dans un environnement mondial chahuté. En réalité, cet essor socio-économique est porté par des choix stratégiques assumés et un cadre macroéconomique jugé sain et stable. Preuve à l’appui : les exportations industrielles marocaines ont plus que doublé depuis 2014. Un indicateur que le souverain présente comme le marqueur d’un « renouveau industriel sans précédent ».
Ce rebond s’appuie sur des secteurs ciblés : automobile, aéronautique, énergies renouvelables, agroalimentaire et tourisme, désormais érigés en piliers de l’économie émergente du royaume chérifien. Le Maroc, affirme le roi Mohammed VI, est désormais lié à plus de 3 milliards de consommateurs dans le monde via ses accords de libre-échange. Ce positionnement est soutenu par un socle d’infrastructures modernes et conformes aux standards internationaux, que le souverain qualifie de « robustes ». De quoi placer le Maroc dans le cercle restreint des économies à large rayonnement commercial.
Parmi les chantiers récents mis en avant figurent l’extension de la Ligne Grande Vitesse (LGV) entre Kénitra et Marrakech, ainsi que plusieurs projets structurants dans les domaines de la sécurité hydrique, de la souveraineté alimentaire et de l’indépendance énergétique. L’ensemble donne à voir un Maroc qui, malgré les incertitudes climatiques et géopolitiques, entend poursuivre sa mue vers un modèle productif plus diversifié, compétitif et résilient, sans rupture avec les équilibres macroéconomiques fondamentaux.
Au-delà des indicateurs macroéconomiques, le souverain a tenu à rappeler l’importance du développement humain comme finalité de toute action publique, ainsi que les efforts réalisés dans le cadre de la généralisation de la protection sociale et de la mise en œuvre de l’aide directe aux ménages. Il convient de noter que la pauvreté multidimensionnelle est passée de 11,9 % en 2014 à 6,8 % en 2024, selon le recensement général de 2024. Ce progrès permet désormais au Maroc d’intégrer la catégorie des pays à “développement humain élevé”. Ces avancées restent, cependant, inégalement réparties sur le territoire, et notamment en milieu rural.
De la grâce royale à la justice territoriale : un cap de transformation

« Il n’y a de place, ni aujourd’hui, ni demain, pour un Maroc avançant à deux vitesses », affirme le roi du Maroc, en écho aux tensions sociales que suscitent les écarts d’accès aux services publics, aux infrastructures et aux opportunités économiques, notamment en milieu rural. Ce constat sert de point de départ à un appel à la refonte des politiques publiques territoriales, dans une logique de rattrapage, de rééquilibrage et de dignité.
Dans cette optique, le souverain invite à un changement de paradigme dans l’action publique. « Nous appelons donc à passer des canevas classiques du développement social à une approche en termes de développement territorial intégré », souligne-t-il, en plaidant pour une refonte en profondeur des politiques publiques locales. L’objectif, énoncé sans ambiguïté, est que « sans distinction ni exclusion, et dans quelque région que ce soit, les fruits du progrès et du développement profitent à tous les citoyens ».
Ce recentrage territorial s’inscrit dans le prolongement de la régionalisation avancée, consacrée par la Constitution de 2011 mais encore inégalement mise en œuvre. Le roi appelle ainsi à en consolider les fondements en misant sur la valorisation des spécificités locales, la solidarité entre territoires et une gouvernance décentralisée renforcée. Cette nouvelle génération de programmes devra donc s’articuler autour de priorités claires : l’emploi local, les services sociaux de base, la gestion de l’eau et la mise à niveau des territoires. En filigrane, cette séquence du discours dit aussi autre chose : elle recentre la doctrine royale sur les réalités territoriales. Désormais, ce n’est plus seulement la croissance qui importe, mais la justice dans sa répartition.
Dans cet esprit, le roi a voulu marquer cette Fête du Trône 2025 par une mesure forte : la grâce exceptionnelle de 19.673 personnes. Cette initiative à forte portée symbolique fait écho à un autre geste fondateur du début de règne : en 1999, tout juste intronisé, le jeune monarque avait gracié 46.212 prisonniers, un acte perçu à l’époque comme un signe majeur de changement et de rupture avec l’ancien ordre.
Cette mesure tombe à point nommé, alors que le pays engage des réformes profondes de son système judiciaire. Trois chantiers majeurs structurent cette dynamique : la mise en œuvre imminente des peines alternatives pour réduire la surpopulation carcérale, la révision du code de la procédure pénale pour une justice plus équitable, et le projet de réforme du code de la famille, qui entre dans sa dernière ligne droite.
Parallèlement, le discours royal se tourne vers l’horizon géopolitique immédiat. Le roi du Maroc choisit de réaffirmer son attachement au principe de bon voisinage, et surtout, de renouveler sa main tendue à l’Algérie.
Mohammed VI, la constance d’une main tendue

Dans un contexte régional tendu, marqué par la rupture unilatérale des relations diplomatiques par Alger en août 2021, le souverain maintient une ligne constante : celle du dialogue et de la désescalade. « J’ai constamment tendu la main en direction de nos Frères en Algérie. J’ai également exprimé la disposition du Maroc à un dialogue franc et responsable ; un dialogue fraternel et sincère », a-t-il déclaré. Une posture qui prolonge les messages des dernières années, et réaffirme une diplomatie de la main tendue, malgré les fermetures politiques et physiques imposées par l’autre rive.
Néanmoins, la question du Sahara a connu une évolution diplomatique notable depuis 2020. En effet, le plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 bénéficie d’un soutien international croissant de 116 pays dans le monde, soit plus de 60% des États membres des Nations Unies. « Nous exprimons Nos remerciements et Notre considération au Royaume-Uni ami et la République Portugaise pour leurs positions constructives venues appuyer la Proposition d’Autonomie », a-t-il dit. Ce basculement diplomatique a clairement déplu à Alger, qui s’est montrée farouchement opposée à cette dynamique.
Mais au-delà de la relation bilatérale, c’est l’idéal maghrébin qui demeure aujourd’hui en suspens. Le roi le rappelle d’ailleurs sans détour : « Nous réaffirmons également notre attachement à l’Union du Maghreb dont Nous sommes persuadés qu’elle ne pourra se faire sans l’implication conjointe du Maroc et de l’Algérie, aux côtés des autres États frères ». Un engagement qu’il avait formulé récemment lors du 34e Sommet de la Ligue des États arabes: « Face à cette situation, Nous ne pouvons que déplorer, une fois de plus, le fait que l’Union du Maghreb Arabe ne remplisse pas son rôle naturel de levier de développement commun pour les pays maghrébins […] ».
En appelant à sortir des logiques figées et en tendant à nouveau la main à l’Algérie, le roi redonne souffle à une ambition régionale longtemps entravée : celle d’un Maghreb uni et tourné vers l’avenir. Les défis sont certes nombreux, mais leur reconnaissance au plus haut niveau de l’État trace un cap clair. Reste désormais au prochain gouvernement à en faire une action concrète et durable.




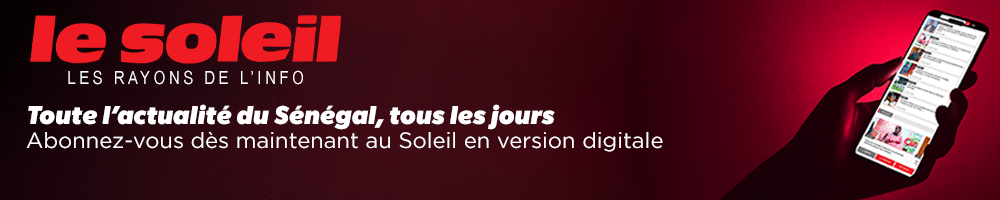



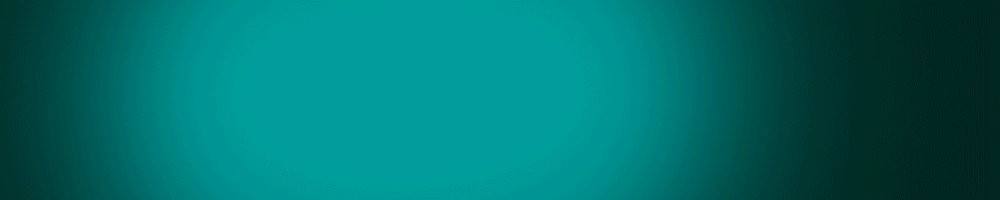

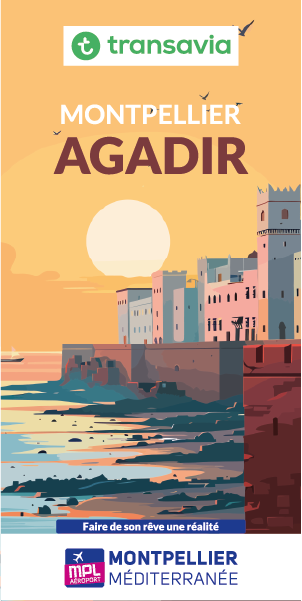
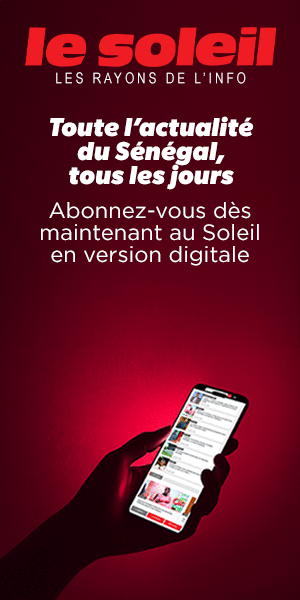









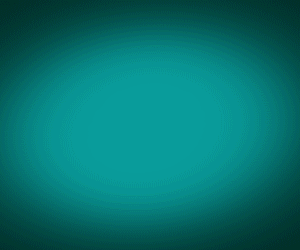










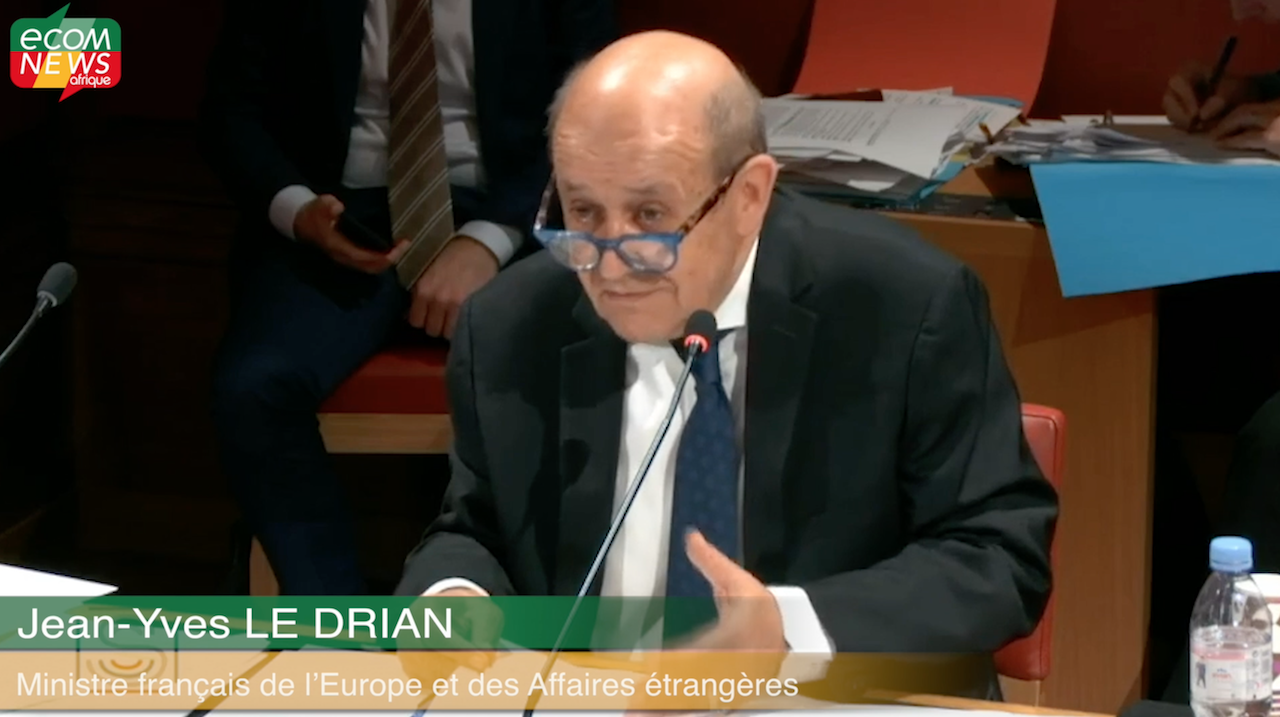

Réagissez à cet article