L’Égypte compte 66 femmes juges sur plus de 16 000 postes pour 104 millions d’habitants. Comment expliquer cette faible représentation des femmes dans la magistrature ? Pour Omnia Taher Gadalla, juriste et chargée d’enseignement à l’École de droit de l’Université Al-Azhar, les femmes diplômées en droit en Égypte se heurtent non seulement à des obstacles propres à la sphère judiciaire, qui ne leur permettent pas de candidater, mais aussi à des résistances de la société elle-même.
D’après le rapport du Global Gender Gap Report 2018, l’Égypte se classe 135e sur 149 pays ; cela reflète une situation très décevante et insatisfaisante, qui ne répond pas aux aspirations des femmes égyptiennes alors même qu’une femme est devenue avocate pour la première fois en 1933 et que le droit de vote des femmes a été autorisé avant d’autres pays africains, arabes et même certains pays européens. Plus d’un siècle plus tard, très peu de choses ont changé, en ce qui concerne la participation des femmes aux postes de décision, notamment dans la sphère judiciaire.
LA PLACE DES FEMMES AU SEIN DU SYSTÈME JUDICIAIRE EN ÉGYPTE
L’une des discriminations subies par les femmes en Égypte réside dans le fait qu’on leur interdit d’accéder à la fonction de juge. Ainsi, le système tel qu’il est aujourd’hui empêche les femmes diplômées en droit – moi y compris – d’accéder, au même titre que leurs homologues masculins, à des postes de juge, même si ces femmes figurent parmi les dix meilleurs étudiants en droit, toutes écoles confondues, en Égypte.
Cette discrimination persiste, en dépit de nombreuses Conventions internationales qui garantissent aux femmes le droit de siéger en tant que juges, telles que la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDEF) en 1979 et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples en 1981.
La Constitution de l’Égypte datant de 2014 semble pourtant aller dans le sens des conventions internationales puisqu’elle contient des articles qui garantissent explicitement aux femmes le droit d’être nommées au sein de toutes les autorités judiciaires. Ainsi, l’article 11 souligne, par exemple, la responsabilité de l’État à « garantir le droit des femmes à occuper des postes à responsabilité dans l’administration au sein de l’État et à être nommées au sein de l’autorité judiciaire sans discrimination aucune ». L’article 53 condamne toute discrimination, pointant là aussi la responsabilité de l’État qui doit « prendre expressément les mesures nécessaires afin d’éliminer toutes formes de discrimination, et la loi se doit, pour cela, de créer une commission indépendante luttant contre les discriminations »[1]. L’article 9 affirme le principe d’égalité des chances et d’égalité, comme l’article 14 le rappelle, et met en avant le fait que la nomination au sein de la fonction publique doit être fondée sur le mérite.
L’IMAGE QUE CELA RENVOIE
L’absence de femmes juges en Égypte est liée à la perception des hommes du rôle des femmes au sein de la société, celui de la femme au foyer, sous-estimant ses capacités et malheureusement mettant à mal la perception de certaines femmes d’elles-mêmes, dans un monde dominé par les hommes. À cela s’ajoute à des idées fausses selon lesquelles l’islam interdirait notamment de nommer des femmes juges.
Tous ces facteurs jouent un rôle et cela, même si les plus hautes autorités religieuses publient des fatwas autorisant les femmes à siéger en tant que juges.
De façon surprenante, les oppositions les plus ferventes ont émané et émanent toujours du système judiciaire lui-même, alors qu’aucune interdiction n’est explicitement formulée dans les textes régissant le pouvoir judiciaire.
Dans les faits, tout diplômé en droit peut postuler pour entrer au Conseil d’État – les cours administratives –, au ministère public, dans les tribunaux militaires, les tribunaux administratifs (APA) et l’Autorité des tribunaux égyptiens (ESLA)[2]. Ces deux dernières structures sont les seules entités où les femmes diplômées en droit peuvent en réalité candidater.
Les chiffres eux-mêmes reflètent cette situation, avec le très faible pourcentage – seulement 0,5 % – de femmes égyptiennes occupant le poste de juge. On compte seulement 66 femmes juges pour 16 000 juges hommes, sur une population de 104 millions d’habitants. Ces dernières n’ont pas été nommées de la même façon que leurs confrères ; elles ont été sélectionnées pour travailler uniquement dans les tribunaux de droit commun au sein des membres déjà nommés à l’APA et l’ESLA. De telles nominations ne correspondent pas au processus habituel, le ministère public étant la voie à suivre pour entrer au sein des tribunaux de droit commun.
Bien que la loi régissant l’autorité judiciaire ait inclus un article qui stipule que les avocats peuvent être nommés juges selon certaines conditions, cet article n’a cependant été appliqué qu’une fois il y a des décennies, lors de la nomination de Tahany El-Gebaly qui a été la première femme nommée juge en 2003 à la Cour suprême. À l’époque de sa nomination, Tahany El-Gebaly était avocate et n’avait jamais exercé la fonction de juge au cours de sa carrière. Les femmes égyptiennes ont pensé que cette nomination à ce haut niveau enverrait un signal fort pour mettre un terme à cette exclusion et serait un pas de plus vers l’égalité. Mais cela ne fut pas le cas, puisque les femmes diplômées en droit continuent d’essuyer des refus lorsqu’elles candidatent à ces fonctions au sein du système judiciaire. La sous-représentation des femmes égyptiennes à ces postes a un impact sur la façon dont la justice est rendue et montre les nombreuses idées reçues – à la fois d’un point de vue social, culturel, traditionnel et religieux – que les femmes égyptiennes ont encore à déconstruire.
MON EXPÉRIENCE
En janvier 2014, il m’a été impossible – avec d’autres femmes – de candidater pour devenir juge. Ainsi, j’ai déposé deux plaintes invoquant le droit des femmes à être nommées juges mais malheureusement, j’ai perdu la première affaire au motif que « je suis une femme ». Cette décision a été rendue en 2017, « l’année des femmes », selon les déclarations mêmes du président égyptien, Abdelfattah El-Sisi.
Le jugement rendu indique que les motifs de rejet des candidatures des femmes étaient fondés sur le pouvoir discrétionnaire de l’autorité judiciaire de décider de l’éligibilité des femmes à occuper de tels postes et a, de manière surprenante, nié la discrimination basée sur le genre.
L’absence de motifs valables dans ce jugement reprend plus ou moins ceux invoqués dans le passé. Néanmoins, auparavant, la décision reconnaissait tout de même le principe d’égalité entre les femmes et les hommes bien que les nominations pour ces postes au sein du pouvoir judiciaire soient réservées uniquement aux hommes diplômés en droit.
Alors que la seconde plainte est toujours en cours d’examen par la Cour suprême administrative, au sommet du Conseil d’État, j’ai soumis une requête pour qu’elle soit transférée à la Cour suprême constitutionnelle en février 2018. L’affaire a été ajournée à plusieurs reprises, voilà six ans maintenant, donnant raison à l’adage selon lequel « une justice différée est une justice refusée ».
MILITER POUR LES DROITS DES FEMMES À ACCÉDER À LA MAGISTRATURE
Mon militantisme m’a conduit à créer l’initiative « Her Honor Setting the Bar » en 2014.
Cette initiative croit en l’importance d’avoir des femmes juges et à son impact sur la légitimité de la justice en termes de transparence et d’accès à celle-ci, et plus largement pour le respect des droits humains. Elle a aussi pour objet d’accompagner et soutenir les jeunes femmes diplômées en droit dans les procédures juridiques à suivre pour déposer leur candidature, porter plainte et lancer les poursuites nécessaires, en leur apportant les documents juridiques requis et des éléments de plaidoyer.
Cette initiative a pour ambition de porter ce combat à l’attention de l’ensemble de la société égyptienne et au-delà. Le plaidoyer fait auprès des députés a permis que ces derniers adressent des questions au ministre de la Justice et au président du Parlement, en plus du projet de loi soumis en décembre 2017 qui n’a toujours été voté. L’association alerte aussi les journalistes pour que les voix des femmes soient entendues et que leurs histoires puissent être soutenues. Néanmoins, la presse n’a pas pu dernièrement obtenir l’autorisation de publier sur ce sujet, comme elle le faisait auparavant.
Nous interpellons des personnalités publiques et les pouvoirs publics et avons porté nos revendications jusqu’aux plus hautes instances, en alertant le président égyptien, la Première dame, le Premier ministre, le ministre de la Justice, le président du Parlement, le président du Conseil suprême de la magistrature, le président du Conseil d’État, le président du Conseil national des droits de l’homme et la présidente du Conseil national des femmes (NCW), et ONU Femmes Égypte. Et cela en vain.
Nous avons construit un vaste réseau aux niveaux national et international, que nous informons régulièrement. Nous travaillons également en lien avec la plupart des organisations féministes et de défense des droits humains et nous faisons campagne ensemble sur ce sujet. L’association a participé à plus de vingt-cinq conférences et colloques au Caire, à Alexandrie et Tanta. Il n’existe pas à ce jour d’association de femmes juges en Égypte mais nous avons, bien sûr, contacté de nombreuses femmes juges égyptiennes pour avoir leur soutien. Aucune ne souhaite, néanmoins, publiquement s’opposer aux pratiques actuelles de la justice de peur de perdre son travail.
Il est inutile de dire que nous avons rencontré une opposition forte de la société et au sein du système judiciaire. Récemment, le Conseil d’État a refusé d’enregistrer toute plainte venant de femmes diplômées en droit en 2017 – alors que les plaintes sont essentielles dans la constitution des dossiers : nous avons dû le faire par mail. L’agent de police au commissariat a même refusé de faire un rapport qui aurait prouvé le refus du Conseil d’État d’enregistrer ces plaintes. J’ai été moi-même privée de mes droits à la défense lors de ma première plainte. Le problème réside dans le fait que le Conseil d’État représente à la fois notre pouvoir judiciaire et notre opposant, ce qui signifie que nous déposons des requêtes au Conseil d’État alors même qu’il est l’instance que nous poursuivons. Dans ce contexte, de nombreuses plaignantes ont refusé de poursuivre le processus de litige pour différentes raisons : le refus de la famille, la perte d’espoir et d’intérêt, la difficulté d’allier vie professionnelle et vie personnelle, la peur des conséquences quant au fait de s’opposer à la justice et au gouvernement, la peur de perdre la possibilité d’être nommée à des postes prestigieux à l’APA ou à l’ESLA. Je suis personnellement confrontée à tous ces risques mais j’ai fait le choix de continuer ce combat.
Source : Fondation Jean Jaurès
Cet article a été traduit en français à partir de l’article : Omnia Taher Gadalla, « The Egyptian Woman Judge : Setting the Bar for Gender Equality », Institute for African Women in Law, 8 janvier 2020.




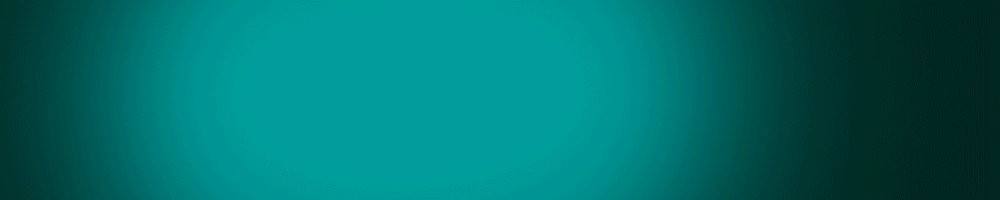



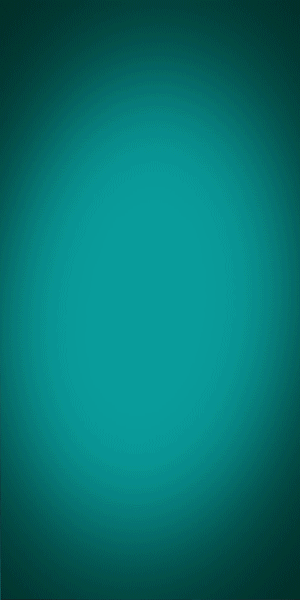














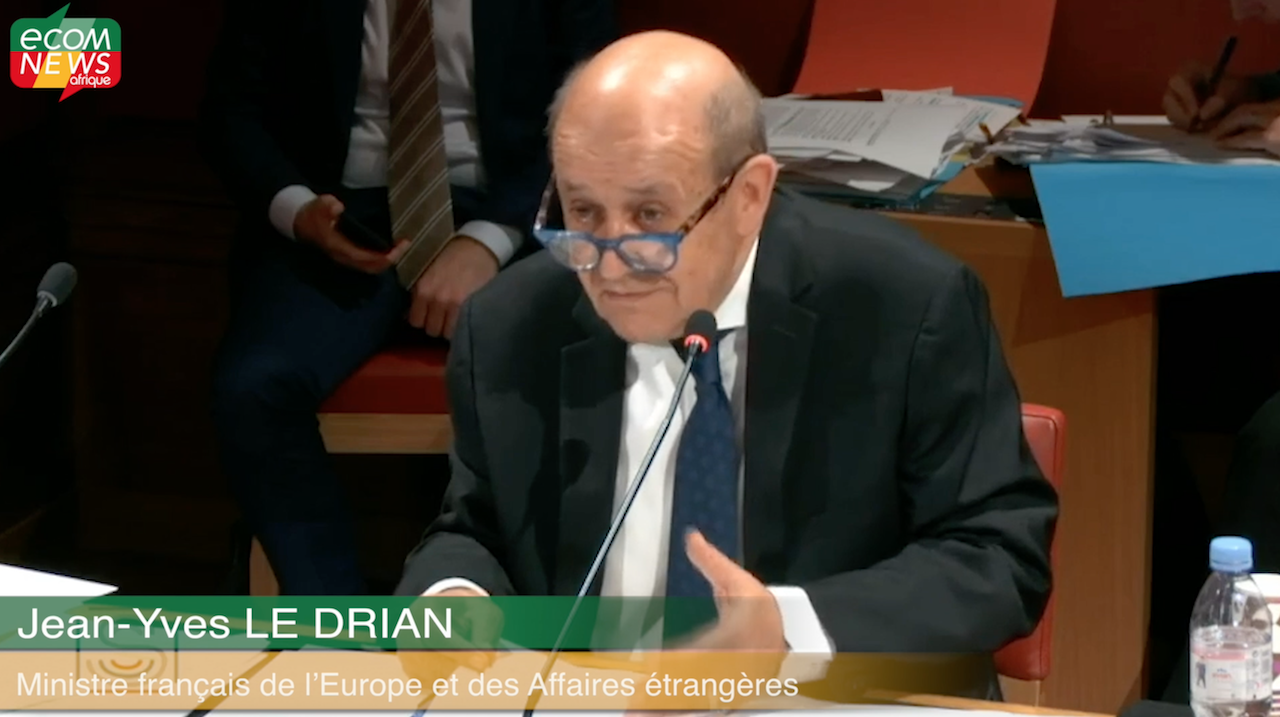

Réagissez à cet article