L’intensification de la guerre au Liban à partir de septembre 2024 a constitué un choc additionnel sur l’économie libanaise. La Banque Mondiale estime l’impact du conflit sur la croissance réelle à -6,6% a minima en 2024. Sa prévision de croissance pour 2024 s’établit désormais à -5,7%, étant entendu que le Liban a déjà connu une contraction de son PIB réel de -34% en 5 ans, effaçant l’équivalent de 15 ans d’acquis de croissance.
La baisse du PIB à court terme serait avant tout causée par la réduction de la consommation privée et des exportations, ce que semblent confirmer les premiers indicateurs microéconomiques disponibles.
L’indice PMI a été ramené de 47 points en septembre à 45 points en octobre, son niveau le plus bas depuis février 2021.
Le trafic s’est effondré à l’aéroport de Beyrouth en octobre (-63% de passagers et -47% de mouvements d’avions) et le nombre de touristes a diminué de -24% sur les 8 premiers mois de l’année.
Or le secteur touristique – très largement porté par la diaspora – avait constitué le principal facteur de la stabilisation de l’économie en 2023 (les revenus touristiques ont représenté 27% du PIB en 2023, soit presque autant que les transferts de fonds estimés à 33% du PIB).
La situation sociale est de plus en plus préoccupante.

La Banque Mondiale estimait, avant la guerre, le taux de pauvreté absolue (<3$/jour) à 33% pour la population libanaise et 44% en comptant les réfugiés syriens.
Alors que l’accès aux services publics de base est de plus en plus limité, l’afflux de déplacés (entre 800 000 et un million) a créé une crise humanitaire risquant d’accroitre les tensions sociales.
Les perspectives de reconstruction sont très incertaines, à moins d’une sortie de l’inertie politico-institutionnelle et d’une mise en œuvre des réformes structurelles (à commencer par la restructuration du secteur bancaire).
Les destructions de capital – 3,4 Md$ estimé à fin octobre par la Banque Mondiale – vont grever la croissance potentielle, déjà très fragilisée par l’effondrement du secteur bancaire et des services publics.
Le pilotage de la reconstruction nécessite un État libanais fonctionnel, tandis que son financement implique que la communauté internationale puisse octroyer des prêts au vu des montants en jeu, ce qui est difficilement envisageable sans assainissement macro-financier du pays.
La communauté internationale devra en outre réapprendre à travailler avec les structures étatiques, qu’elle a largement contournées ces dernières années.
Les réformes structurelles sont tout autant nécessaires pour enrayer la tendance de fond à l’œuvre depuis 2019, qui voit l’économie libanaise s’informaliser et baisser en gamme.
Le secteur privé formel, déjà affaibli par la pénurie de financements bancaires et des coûts énergétiques prohibitifs, enregistre des pertes significatives du fait de la guerre (5,1 Md$ en 12 mois d’après la Banque Mondiale), et perd des parts de marché face aux acteurs informels.
La pénurie d’emplois de qualité devrait ainsi s’accentuer, incitant encore davantage à l’émigration qualifiée, ce qui augmentera la dépendance de l’économie à la diaspora.
Ce constat alarmant démontre la nécessité de soutenir les entreprises libanaises les plus productives, en leur fournissant des outils de financements adaptés.
En l’absence de sursaut en faveur des réformes, le Liban risque en effet de s’ancrer dans un paradigme de sous-développement, dans lequel l’aide internationale en don, dirigée vers les populations vulnérables (estimée à plus d’1 Md$/an avant la guerre), constituera une rente financière d’appoint.




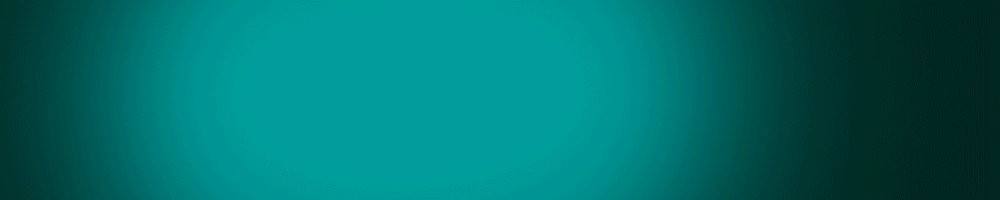






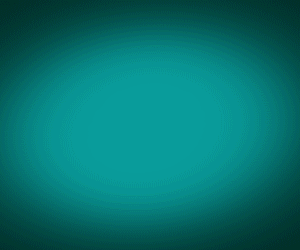










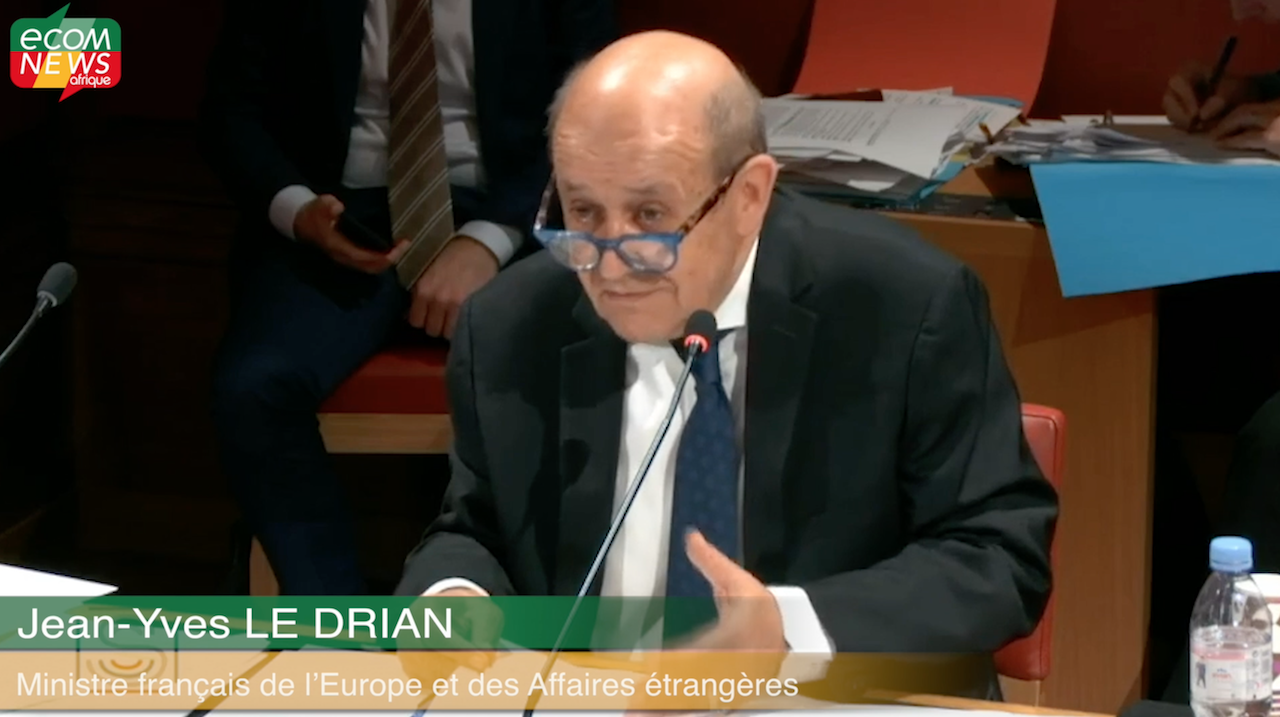

Réagissez à cet article