L’Égypte fait face à une situation aggravée de stress hydrique. Avec un déficit annuel de 54 Mds de m³, les ressources naturelles en eau du pays (dont 90 % proviennent du Nil) ne permettent de couvrir que 52 % des besoins.
Les besoins résiduels sont assurés la réutilisation des eaux usées et le recours aux importations de denrées alimentaires afin de contenir la pression du secteur agricole sur la ressource en eau. Aujourd’hui, 570 m³ d’eau sont disponibles par an et par habitant en Égypte, en deçà du seuil de pauvreté de l’ONU (1000 m³).
Pour pallier ce défi, l’Égypte a consenti des investissements significatifs dans le développement d’infrastructures de traitement des eaux, destinées tant à l’usage domestique qu’agricole.
Le pays dispose d’un réseau de 508 stations d’épuration, permettant de traiter 89 % des eaux usées. Ce niveau d’assainissement ne couvre toutefois que 65 % de la population. Le pays a également développé un vaste réseau de canaux d’irrigation (55 000 km – dont 20 000 km en cours de réhabilitation) et de stations de pompage, alors que le secteur agricole, stratégique pour l’économie (14 % du PIB) repose à 96 % sur l’irrigation et absorbe 85 % des ressources en eau.
La sécurisation de la ressource en eau figure ainsi parmi les priorités du gouvernement, catalysant à ce jour 43 projets financés pour un total de près de 5 Mds USD, soit environ 20% de l’aide au développement totale reçue par le pays.
Le modèle de gestion et le faible prix de l’eau participent à la fragilité financière du secteur, qui demeure subventionné par l’État.
Ce modèle ne permet pas d’investir suffisamment dans la maintenance des infrastructures, aujourd’hui dans des états très inégaux. Les petites stations d’épuration, souvent vétustes, souffrent de problèmes de gestion, certaines ne fonctionnant qu’à moitié de leur capacité.
De même, le réseau de distribution subit d’importantes fuites, estimées à 34 % par la Banque Mondiale. Enfin, seuls 18 M de foyers sont abonnés au réseau. Les pertes financières annuelles seraient estimées à 2,3 Mds EGP (45 M EUR) par an.
Pour relever ces défis, le gouvernement prévoit une libéralisation progressive du secteur, en favorisant des partenariats public-privé (PPP) et des mécanismes de rémunération axés sur la performance.
Dans ce cadre, un vaste programme de dessalement reposant sur des projets PPP a été lancé, visant à produire 9 M m³ d’eau potable par jour d’ici 2050. Les appels d’offres pour la première phase, qui mobilisera 3 Mds USD d’investissements, sont attendus pour 2025, alors que 17 consortia ont été présélectionnés en 2023.
L’UE et l’Égypte ont en outre signé une facilité de financement de 7 M EUR via des PPP, dans le cadre de la plateforme NWFE, destinée notamment à soutenir la gestion de l’eau.
Enfin, la question du traitement des boues d’épuration devenant centrale, un appel d’offres pour un projet pilote en PPP visant à valoriser les boues de la station Abu Rawash (1,6 M m³ d’eau traités / jour) devrait être publié l’année prochaine.
L’intérêt marqué des autorités égyptiennes sur ces enjeux s’est confirmé lors d’un voyage d’étude en France, organisé fin novembre par la DG Trésor, et regroupant plusieurs acteurs décisionnels clés du secteur de l’eau..
Source Ambassade de France en Egypte




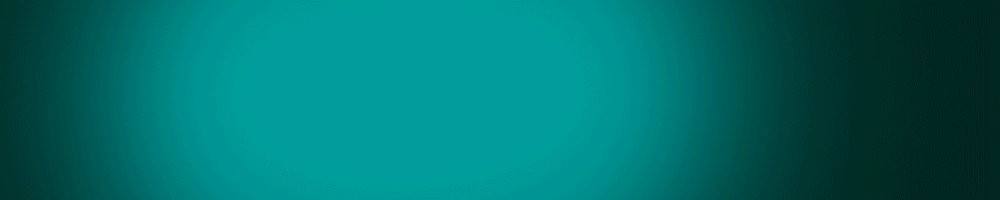






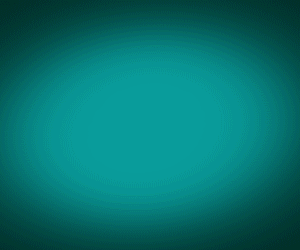











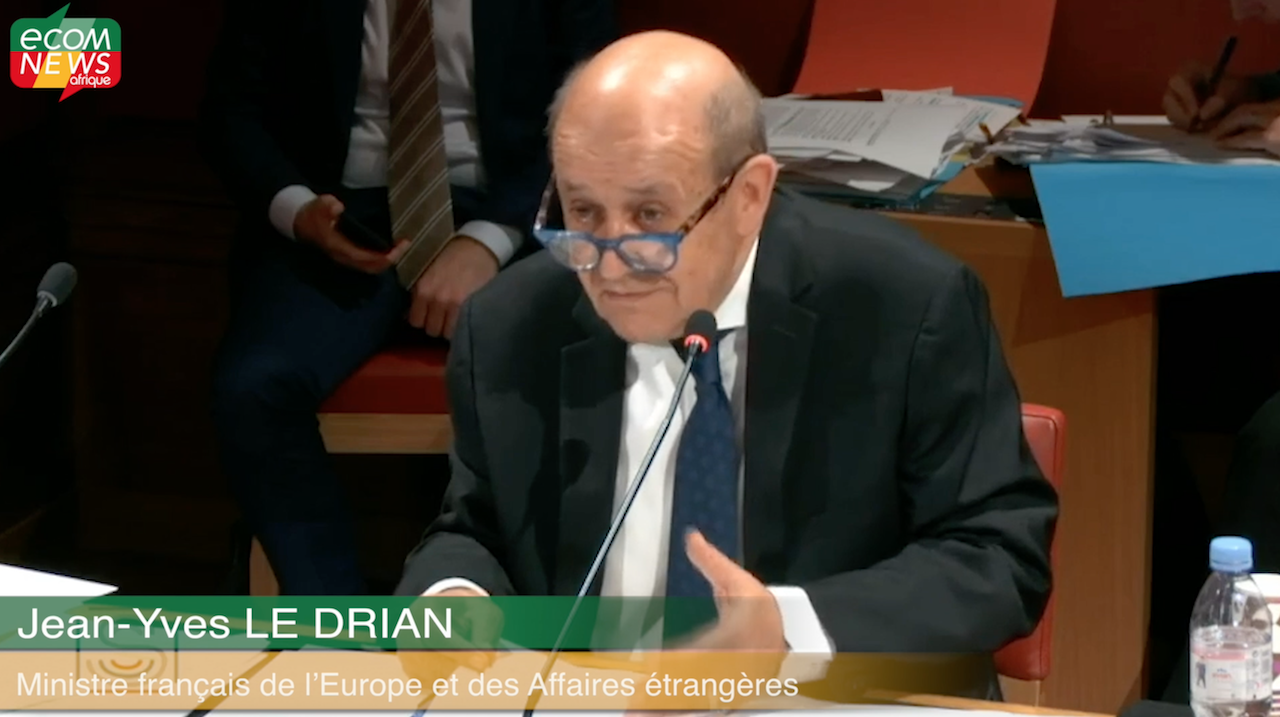

Réagissez à cet article